07:37
Le verbe en peul
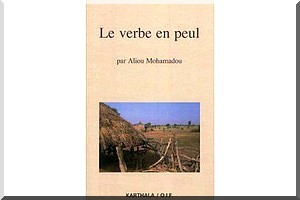
Impossible de se soustraire à l’évolution d’une langue. Celle-ci progresse en fonction du temps et sa structure linguistique se métamorphose suivant les éléments qui l’entourent. Et le verbe est au centre de tout.
C’est à cette mue que s’attaque le Camerounais Aliou Mohamadou, professeur de peul à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) à Paris. Auteur de plusieurs travaux scientifiques, il suit le peul à travers son écriture dans la presse, mais aussi dans les productions littéraires (roman, conte, nouvelle, essai). Évolution verbale et nuances à traquer, il sait.
Notons qu’à côté de l’utilisation latine du peul, ici étudiée, il y aussi l’ajami, retranscription à travers l’alphabet arabe, procédé demeuré pendant longtemps à l’usage des marabouts et de leurs talibés.
Au-delà du vocabulaire qui connaît des modulations, ou sens seconds, d’une région à une autre, ce livre s’articule « entre la forme et la bonne formation grammaticale, entre ce que l’on dit, ce que l’on écrit et la norme graphique ». La tâche n’est pas aisée, tellement les avis linguistiques et querelles d’écoles sont complexes. Les parlers du peul présentent des déclinaisons jusque dans leurs dénominations géographiques.
De l’Afrique centrale (Cameroun, Tchad, Nigeria, République Centrafricaine) dite zone de l’Aadamaawa, au Fuuta-Tooro, région de la Mauritanie, du Sénégal et de l’Ouest du Mali, en passant par le Burkina et l’Ouest du Niger pour le Maasina et la Guinée le Fuuta-Jaloo ; on parle tantôt du fulfulde tantôt du pulaar !
L’auteur circonscrit son champ, afin de comprendre : « comment se présente le verbe en peul […] ? Quelles sont les formes verbales que l’on peut distinguer dans cette variante ? Quels en sont les valeurs et emplois ? Quels sont les modèles de conjugaison que l’on peut proposer pour des radicaux, des désinences qui leur sont suffixés et des marqueurs qui leur soient par ailleurs associés en présence de ces suffixes ? »
Pour éviter d’affaiblir tel ou tel aspect, Mohamadou a choisi « d’ancrer la description dans une seule variante dialectale qui soit suffisamment représentative et sur laquelle on dispose des données fiables, facilement accessibles et vérifiables ». Il s’agit du pulaar du Fuuta-Tooro. Rien de simple non plus, car l’auteur fait observer que le dialecte du Fuuta-Tooro comprend lui-même plusieurs parlers dont celui du Tooro, autour de Podor, et ceux du Damga et du Ngenaar dans la région de Matam au Sénégal.
Pour ceux qui pourraient se poser des questions sur les choix, le chercheur abdique : « d’autres traits dialectaux auraient mérité d’être signalés. Mais dans la réalité des choses, la dialectologie peule est à faire ou à refaire fondamentalement en s’appuyant à la fois sur des enquêtes portant sur la phonétique et la phonologie, sur la grammaire et le vocabulaire, et sur l’analyse de corpus suffisamment représentatifs que l’on réunirait d’un parler à l’autre… »
Il n’en demeure pas moins que ce livre d’Aliou Mohamadou constitue une avancée significative dans l’étude de la langue et de son constituant verbal, ses formes prédicatives de l’infinitif, ses accomplis et inaccomplis. De nombreuses trouvailles, et leçons donc, à la disposition du lecteur ou chercheur qui voudra plancher sur cette langue peule parlée par près de trente millions de personnes en Afrique et dans une quinzaine de pays, selon l’hebdomadaire Jeune Afrique[1].
[1] Jeune Afrique n°2721 du 3 au 9 mars 2013
Notes de lecture par Bios Diallo