20:27
MS.Hamody a propos de : La Mauritanie trace sa route de P. Lepidi
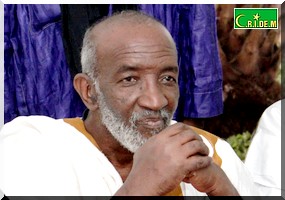
Décidemment le littoral atlantique mauritanien, en particulier l’itinéraire Nouadhibou -Nouakchott, ne cesse d’interpeller, d’attirer et séduire et pour bien de raisons. Déjà, dans l’antiquité, des grecs, des perses, des Romains et nos cousins Carthaginois ont hanté nos côtes à la recherche de quelques terres à coloniser, ou de quelque richesse à exploiter.
Au Moyen Âge chrétien nos ancêtres Almoravides y auraient construit leur premier « Ribat » avant d’aller conquérir, depuis le royaume du Ghana jusqu’à l’Andalousie musulmane : fortune, célébrité et, pour prosélytisme et autres actions pieuses, solliciter récompense d’Allah.
Dans les temps modernes navigateurs portugais, espagnols, français, hollandais, anglais et prussiens s’y affrontèrent âprement. Qui pour installer des comptoirs de commerce, qui pour s’approprier quelque autre privilège impérial.
A l’époque contemporaine, la traite de la gomme, puis la pêche des crustacés ne furent éclipsés, pour un temps seulement, que par le naufrage de La Méduse, en I816, immortalisé par le peintre Géricault. Plus prés de nous, les scientifiques Gruvel et Chudeau, en 1909, puis le professeur encyclopédiste Théodore Monod, en 1923, et, dans les années trente, l’écrivain Odette de Puigaudeau, feront redécouvrir aux français la côte de Mauritanie et… ses mille et une merveilles.
En 2005, voilà le littoral objet d’un nouvel éclairage du journaliste Pierre Lepidi dans son livre Nouakchott -Nouadhibou, la Mauritanie trace sa route où il étale les
« sentiments très forts » qu’il ressent pour la Mauritanie et ses habitants. L’ouvrage décrit « ce chaînon manquant permettant de relier l’Europe à l’Afrique, de rapprocher les hommes et même un peu les deux continents. »
A cette fin, l’auteur explore le passé, décrit le présent et essaye de deviner le futur de cette portion du pays dont le poids ne cesse de grossir…
De la route , M. Lepidi fait le rappel historique concis et instructif de la genèse , la description attentive et complète de l’itinéraire, l’évocation des conflits sociaux qu’elle provoque, et l’énumération, presque exhaustive, de ses nombreux autres enjeux .
En prime il nous livre, en des encadrés succincts mais forts éloquents : le profil de la Mauritanie, la fiche technique de la voie, son montage financier, les entreprises se partageant ses lots, « les conditions dantesques de sa réalisation
» …Qui plus est, l’auteur ne nous laisse pas sur notre faim quand il fait les monographies de Nouakchott et de Nouadhibou, exposant les problèmes les plus cruciaux de la capitale politique dans l’une, de la capitale économique dans l’autre. Il présente, également, au lecteur les potentialités économiques du pays qui justifient et rentabilisent l’investissement.
Cette aventure historique de la route et de sa zone géographique, où les vies de l’homme et de la courbine sont attestées déjà au paléolithique, fait l’objet d’un examen sans complaisance mais sans exagération, quand l’auteur expose ses dangers : l’immigration clandestine, l’extension du sida …. Il n’occulte pas non plus la problématique écologique et les menaces qui guettent l’environnement à l’équilibre fragile de ce vivier de richesses halieutiques, habitat de populations d’hommes et d’oiseaux, et patrimoine de l’humanité que constituent les douze mille kilomètres carrés du Parc National du Banc d’Arguin.
Le reportage ne se satisfait pas de la seule et frustrante sécheresse des statistiques chiffrées. Les Imraguen, ces vrais et premiers habitants du littoral, reçoivent une correcte attention, même si elle ne nous explique pas suffisamment leur spécificité culturelle et sociologique et leurs étranges techniques. Il nous décrit le nouveau paysage futuriste des pylônes des opérateurs de GSM. Il nous évoque les puits, ces annonciateurs de toujours de la vie au Sahara atlantique.
Il nous fait vivre le début bouleversant de la sédentarisation en ces immensités désertiques, équivalent, toutes proportions gardées, du fameux
« Big Bang » à l’origine de l’existence cosmique. Et il y a l’émouvante touche humaine pour laquelle M.
« nous convie, implicitement, à apprécier avec lui : les témoignages vivants, les espoirs de ceux qui campent sur le parcours de l’axe de communication et qui confient, sobrement et naïvement, comment « la route a changé leur vie. »
Alors, à travers l’excellent travail d’investigation qu’il a réalisé, M.
« n’est plus seulement l’
«historien de l’instant
» . Il est surtout le témoin privilégié que la chance et la perspicacité gratifient d’un moment remarquable de l’évolution d’un pays au point de jonction d’une région (l’Afrique occidentale et le Maghreb) si proche de la « vieille Europe
». De ce pays, il essaye, et réussit en grande partie, à expliquer la profonde mutation. C’est là une contribution de grande qualité et, sans aucun doute à notre avis, une œuvre qui perdurera !