11:35
La Mauritanie et l’Azawad. (VIII)
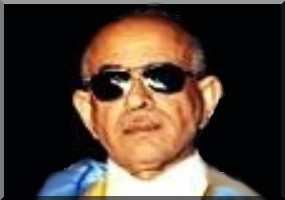
VIII - Prière de supplication de la pluie
Une photo statique du contexte actuel fait ressortir des facteurs d'optimisme. Mais en l'absence de projections ou de scenarios – scénarii, si l’on veut – qui n'ont jamais été tentés, personne ne peut écarter les aberrations, puisque les tendances d’optimisme relevées ont une ''nécessité'' seulement si d’autres facteurs négatifs, latents ou nouveaux, n’intervenaient pas de manière déterminante et ne contrarieraient pas la tendance qui était discernable au départ.
Etant donné la multitude des variables, le diagnostic politique reste, souvent, d’un caractère équivoque et tributaire des nombreuses sources d'erreur. Mais comme dit Clausewitz : « quant il n'existe pas de système, de vérité reconnue, la vérité existe tout de même''. En tout état de cause, c’est le rôle de l’action politique de minimiser l’impact des facteurs négatifs et, à contrario, de maximiser les facteurs positifs.
L'un des facteurs d'optimisme est sans conteste, cette volonté nationale, cette âme autonome, cette force qui chemine souverainement, forçant le passage parfois, sinuant tranquillement souvent, qui emprunte certaines voies et se refuse, imperturbablement, à suivre d'autres chemins qui manquent de sincérité, d'authenticité, et finalement de compatibilité ou d'histocompatibilité.
L'un des facteurs d'incertitude est cette crise économique mondiale qui n'est qu'à ses débuts (toujours), qui secoue le monde, fait tanguer l'Europe et menace de lui arracher sa monnaie et jusqu'à son unité. Elle devrait en toute logique réveiller toutes les consciences nationales et conduire à des approches nouvelles qui ne seraient pas uniquement axées autour du journalier et du contingent.
Il apparait clairement maintenant qu’une politique qui se cantonnerait dans le périmètre des frontières équivaudra à une forteresse sans sentinelles : s'inscrire plutôt dans la perspective d'un vaste ensemble Ouest saharien, qui est notre univers naturel, tout en travaillant concrètement dans le cadre national; autrement dit penser globalement et agir localement. C’est une conclusion déjà tirée.
Il reste à tirer d’autres leçons du passé, pour mieux affronter cet avenir qui est toujours, et dans tous les pays, une énigme et pour mieux franchir de nouveaux pics.La principale leçon du passé est que l'avenir n'a jamais été envisagé à temps et à long terme, dans toute sa complexité et dans ses données les plus déterminantes. Quoi de plus urgent qu'une instance ou une institution, plus exactement, qui aurait pour rôle d'examiner notre avenir et notre destin, dans un monde si inquiétant ?
Les gens qui ont tiré des conclusions de la vie pourront y donner toute la mesure de leur expérience, dans un domaine qui est purement de réflexion et dont aucun n'en attend, à titre personnel, des résultats particuliers. C'est une approche qui devrait s'intéresser surtout à un horizon de 10 ou 20 ans. Mais une telle réflexion sans des jeunes ambitieux pour leur pays n’a pas de sens. Ce sont eux qui doivent s'habituer à avoir une vision lointaine, s'ouvrir des perspectives si larges et si passionnantes que la politique du jour le jour, et du détail, qui a fait tant de dégâts, leur paraitra dégoûtante et les mettrait au service d'une grande cause qui force l'enthousiasme et donne des ailes à l’espoir.
Ils seraient alors des révolutionnaire vrais sur le fond, et de vrais seigneurs dans les méthodes, conscients du temps que leur pays a perdu, connaissant parfaitement ce pays, son histoire et sa société, mais visant de toute urgence ce qui peut le sauver : la modernité dans ce qu'elle a d'essentiel, c'est-à-dire la Raison.
C'est ainsi, qu'on pourra créer une nouvelle classe politique, que beaucoup appellent de leurs vœux, une classe brillante par l'esprit et les valeurs, qui force l'admiration et arrache l'estime, voyant et regardant loin, avec désintéressement, en un mot émancipée des tares de ses aînés. Une classe jeune, seulement par âge, mais reproduisant, avec moins de finesse et moins de précautions morales, les erreurs des anciens, est plus dangereuse que les vieux caïmans du marigot.
On ne sait pas comment les français nous ont ravi la vedette, en instituant dernièrement une commission de moralisation de la vie publique. C'est infiniment plus urgent ici. C'est un autre chantier. Mais il pourrait être plus étendu que l'intitulé ne le laisse présager. La réforme de cet appareil administratif au sens large, qui ne donne satisfaction à personne, pourrait y être incluse et pourquoi des personnalités actuellement hors de l'Etat n'y pourraient elles pas contribuer utilement ? On aura contourné la vérité en disant qu'il n’y a pas d'hommes de qualité en dehors de l'appareil d'Etat.
Il n'est jamais trop tard pour que certaines personnalités apportent leur contribution au fonctionnement si ardu de l'Etat. Il n'est pas non plus trop tôt pour que ceux qui ont pris le large, jetant le manche après la cognée, se reprennent dans l'intérêt général. Le sage Lao - Tseu écrit '' c'est celui qui prend sur lui le déshonneur de la nation qu'on appelle son seigneur''.
Ce que certains soutiennent parfois n'est pas croyable. L’Etat ne peut pas rejeter de citoyens. Seule la loi exclut de l’Etat. L’Etat a intérêt qu’il y ait le maximum de potentialités en son sain, ou dans son sillage, pour pouvoir y puiser à volonté. Il cherche, par nature, par nécessité, la compétence et la sagesse et il sait, comme tout le monde, que la réussite dépend de la qualité des hommes qui composent le Gouvernement (et du modèle de machine politique en vigueur) et il connaît, comme tout le monde, la maxime de la sagesse chinoise : «quand les postes élevés sont tenus par des sages, le peuple aime le gouvernement».
L'Etat est pour tous et il n'est jamais étroit pour ses citoyens. Là où le quiproquo s'installe, c'est quand un citoyen ou un groupe de citoyens se croit supérieur à l'Etat ou veut se mesurer à l'Etat. Là on est moralement et politiquement pénalisé, si on accepte le principe de la démocratie.
On donne parfois l’air de défier délibérément l’Etat et qu’il suffit d’un coup de
poker violent pour rafler la mise. Si c’était si simple ! Dans ce jeu, la mise se
perd en même temps que les joueurs.
Il n’est jamais bon d’agresser délibérément et continuellement.
Le chameau le mieux dressé de la terre, le plus accommodant, si on continue
à passer inconsidérément sous ses jambes, à le frapper gratuitement, finira
bien par donner un coup de patte et un bon jour par se retourner contre
l’importun.
On dit que les chameaux qui tuent le plus de personnes – il y’en a
quelques uns par an – ne sont pas les étalons sauvages qu’on voit au loin, mais le chameau de bât, paisible, qu’on traîne à longueur de journée par la bride et qui, disent les connaisseurs, emmagasine patiemment les mauvais traitements et finit, à la faveur de la solitude, par dévorer son agresseur impénitent, en un moment d’inattention. Il ne se trompe presque jamais d’ennemi, s’il n’a pas déjà goûté le sang humain.
Il n’est pas nécessaire d’éprouver la patience des gens. C’est un état limite que ne sonde, à leurs corps défendant, que ceux qui n’ont rien à perdre ou ceux qui ont perdu leur discernement.
Le moindre discernement dicte de travailler de concert pour préserver l’essentiel de ce qui est commun, pas forcément dans le consensus, mais ne l’excluant pas non plus, dans tous les cas dans la responsabilité. Avant le consensus, il faut d’abord pouvoir se parler correctement. Le consensus est un couronnement, pas un point de départ.
Le principal acquis de notre société a été jusqu’ici l’Etat. Les ruptures et les changements sont inévitables, mais, maîtrisés, de tels sauts et de telles turbulences n’invalideraient pas au moins ce qui a été acquis.
L’Etat est soumis à la même loi de précarité qui régit toutes les choses de ce monde et on ne se fait pas d’illusions. On sait qu’il est très difficile de le rendre éternel. Pourtant le Kanem, chez les Toubous, qui n’est ni Rome, ni la Perse, dura plus de mille ans. Mais, notre Etat, lui, reste un pari. Les menaces et les facteurs, ou les moteurs, qui travaillent contre son existence et sa pérennité sont si nombreux et si variés qu’on serait les derniers étonnés si on nous annonçait que les Mauritaniens ont renoncé volontairement à constituer un Etat.
Si l’idée n’a jamais vraiment été écartée comme hypothèse, c’est qu’elle est soit acceptable dans les cœurs, soit les conditions ne la réfutent pas. Le moment ultime, l’instant du crash, ne fait pas grand mystère. C’est le jour où ceux qui agissent pour ruiner leur Etat n’auront plus en face d’eux d’autres qui y tiennent à tout prix. Il suffit simplement que l’irresponsabilité se généralise et que les derniers résistants, excédés, s’avouent vaincus et disent : «bon, c’est tant pis ! et que le phacochère enfante des jumeaux !» comme dit la langue populaire locale.
La faiblesse de cette entité morale qu’est l’Etat mauritanien, maintes fois relevée, ne cesse d’intriguer, sans jamais rencontrer d’explication suffisante ou convaincante. Sans cette explication, pourtant, le remède, s’il existe, reste aléatoire. Mais une explication ne veut pas dire une seule cause. Il doit bien y avoir plusieurs sources malfaisantes qui ont conduit à ce résultat déplorable. L’une d’elle – comme suggéré plus haut – est contemporaine des premiers balbutiements, des premiers tâtonnements dans l’apprentissage de la marche. C’est là que s’est formé et figé le répertoire de toutes les partitions politiques, ou le paradigme de toutes les grammaires politiques futures, qui devaient être exploités médiocrement, sans jamais vraiment être enrichi sur le fond.
Ce répertoire est caractérisé par la frilosité, l'étroitesse de vues, qui esquive les actions d’envergure, les coups d’éclair de l’intelligence, les audaces, qui s’est régulièrement dérobée au devoir, quand il demande et exige le sacrifice. Les cas où ce sacrifice s’est imposé de lui-même, c’était de la pire des façon. De telle sorte que l’entité morale qu’est l’Etat mauritanien, n’a jamais trouvé d’aliment pour la conforter dans les esprits, presque aucune gloire n’ayant été inscrite à son actif.
La deuxième cause de rupture entre les citoyens et leur Etat tient au fait que cet Etat avait refusé d’assumer l’héritage dont les citoyens pouvaient s’enorgueillir et qui faisait leur fierté : la Résistance héroïque au colonialisme et la culture et la langue arabes.
La troisième, enfin, qui a sans doute nourri de son sein les précédentes et toutes celles qui n'ont pas été relevées, est que l'Etat Mauritanien n'a pas été gagné sur le champ de bataille, comme en Algérie et au Maroc, ni dans l'arène politique après des luttes épiques, comme en Guinée et au Ghana.
C’est tout ce passif qui nous fait boiter de toute part et d’une drôle de manière. Quelles que soient la bonne volonté, la détermination, les dispositions à affronter ce qui n’est plus une maladie mais une nature, il y a le handicap premier, cette tare qui empêche les rendements de correspondre au niveau des efforts, les mots de signifier la même chose pour tous et rend les objectifs vitaux brouillés par l’obscurité qui règne dans les esprits.
Il n’y a pas d’autre choix cependant que de maintenir le cap du volontarisme. Mais, si, jusqu’ici, on a agi sous l’empire pressant, voire oppressant, de la nécessité et de l’urgence, l’obligation qui ne peut plus être différée, qui s’impose, parallèlement, sans retard, est, désormais, de s’atteler à cette tâche ingrate, au choix, méprisée ou inconnue, qui prend ici, nécessairement, l’allure et la solennité de la prière de supplication de la pluie : la tâche de réfléchir.
Par Mohamed Yehdih O. Breideleil