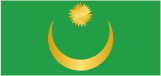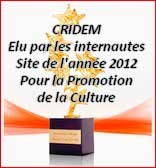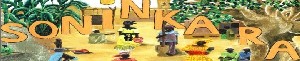15-08-2012 13:32 - La Mauritanie et l’Azawad. (VII)
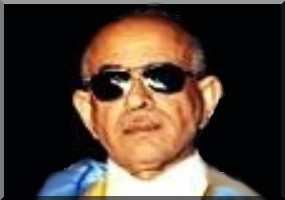
VII- La balance impartiale.
Le Mali est, pour sa part, placé devant ses responsabilités, comme jamais. Va t- il continuer à être prisonnier de l'habitude et des slogans sans réalité sur le terrain ou se rendre à l'évidence et faire le choix de son intérêt réel et éternel : vivre en paix avec les peuples voisins, et d'abord celui de l'Azawad, constitué de populations différentes.
Le greffe n'a pas fonctionné. Ce n'est ni la faute du Mali, ni de celle de l'Azawad.
Si le principal ciment de l'unité est simplement le fait que le colonialisme a donné cette configuration géographique en legs, c'est assez fragile comme fondement et comme argument à opposer à ceux qui veulent jouir de leur indépendance.
Le Général De Gaulle lui – même a accepté en 1961 le choix des Algériens pour l'Indépendance, après 130 ans de coexistence semblable, c'est-à-dire calamiteuse. Il semble même qu'il comprenait, dés 1958, la nécessité pour la France de se débarrasser de ce boulet.
Lorsqu'il a proposé, en 1958, à Couve de Murville d'être son Ministre des Affaires Etrangères, celui-ci, usant comme à l'accoutumée de la litote, a laissé entendre qu'il lui serait difficile d'être au premier rang d'un gouvernement qui devrait continuer la guerre d'Algérie. Le Général De Gaulle lui aurait confié qu'il partageait ses convictions et que le problème est de préparer l'opinion, surtout de l'Armée, et d'élaborer la voie pour une sortie honorable.
C'est ainsi que Couve de Murville aurait accepté le poste qu'il occupera pendant dix ans.
Si on ne peut vivre ensemble qu'au prix de l'oppression à l'égard d'une composante, c'est une position qui n'est pas raisonnable et qui surtout n'est pas tenable. On se demande, de surcroit, pourquoi certaines parties étrangères africaines veulent faire monter d'un cran l'injustice en s'impliquant dans une intervention qui aurait pour objectif de contraindre les Azawadis à rester au Mali.
Si 50 ans n'ont pas suffi à les convaincre, l’intervention étrangère ne les convaincra pas. Elle peut tout juste les réduire comme l'ont fait les différents régimes maliens successifs : progressistes, conservateurs, civils, militaires, démocrates, à parti unique … Mais ce n'est pas suffisant. Un bon jour l'intervention étrangère prendra fin et la rébellion reprendra de plus belle, comme elle le fait de manière répétitive depuis 1960.
Un pays est d'abord fondé sur une volonté des diverses parties de coexister, de vivre ensemble dans la paix. Sans ce choix et cette volonté, c'est une partie perdue, on gaspillera simplement beaucoup de vies humaines et beaucoup d'argent.
Une chose ne laisse pas d'étonner : pourquoi l'indépendance du Sud Soudan s'est faite sans protestation, alors que celle de l'Azawad apparait insupportable aux Africains?
Le système du ''deux poids, deux mesures'' était jusqu'ici l'apanage des Américains, et on sait que Obama n'y a rien pu et aucun Président n’y pourra rien, même si Noam Chomsky devenait, sur le tard, Président des U.S.A. Les Américains ne changeront jamais tant qu'ils sont persuadés de leur ''destinée manifeste''.
Ils resteront des Américains. Lorsque Mussolini a pris le pouvoir en Italie et mis en place son système fasciste, on a dit au Maréchal Hindenburg : attention, l'Allemagne doit maintenant compter avec une puissance dure, dans son voisinage. Le vieux maréchal s'est contenté de cette réponse : '' Les Italiens ne seront pas autre chose que des Italiens''.
C'est à propos de la France qu'on se demande aujourd'hui si elle va être autre chose. Pour la première fois, le Président Français n'a pas, personnellement, d'antécédents coloniaux et ne sort pas d'une officine coloniale. Ces éléments inédits sont – ils suffisants pour que François Hollande infléchisse la politique française dans le monde vers les idéaux proclamés de justice et d'abandon du néocolonialisme ? C'est toute la question. Rares sont ceux qui doutent de la volonté et – disons le - de la sincérité, sans ajouts théâtraux, de François Hollande, mais beaucoup doutent de la capacité de l'appareil à s'amender facilement, à trouver un nouveau langage et surtout à abandonner des pratiques endurcies par le temps.
La CEDEAO, ou toute autre composition, qui voudrait combattre le terrorisme islamiste dans l'Azawad a intérêt à se faire des alliés dans cette région et ces alliés objectifs ne peuvent être que les mouvements laïcs comme le MNLA et le FALA. S'en faire des alliés, c'est reconnaitre les droits de leur peuple et lui ouvrir une perspective de justice et de paix et tourner la page de la domination et de l'oppression.
Tout le monde a intérêt à ce que le Grand Sahara ne soit pas une source permanente d'inquiétude et de danger pour ceux qui le visitent, ou y travaillent ou pour ses voisins. Personne ne doute de la difficulté d'y faire régner de nouveau la tranquillité d'antan.
Aucune intervention étrangère, aucune armée étrangère, aucune base étrangère n'est en mesure d'y faire prédominer la paix d’une manière durable. Une base étrangère au lieu de faire fuir les terroristes ferait l'effet d'une mare de miel sur une nuée de mouches et multiplierait le nombre des extrémistes, de nouvelles vagues de jeunes jusqu'ici indifférents accourront, découvrant de nouveaux motifs d'engagement pour une cause noble, celle de débarrasser la région de l'invasion étrangère.
Une nouvelle cible concrète qui manquait au décor et une leçon de démonstration du danger dont on parlait et qui se matérialise enfin. Le Sahara à une superficie de 8 Millions de Km². C'est un désert inhospitalier dont l'aridité est proverbiale, où l'eau est très rare, les vents de sable quasi – quotidiens et les sables mouvants couvrant pratiquement son quart et de vastes zones sont pratiquement accessibles uniquement aux personnes et aux chameaux.
Ses habitants l'ont dominé tout au long de l'histoire. Ils sont les seuls à pouvoir le dominer aujourd'hui, encore faut-il qu'ils ne se sentent pas eux –mêmes menacés ou exclus. Ce sont trois groupes : les Maures à l'Ouest, les Touaregs au centre et les Toubous à l'Est. L'Est du Sahara semble moins préoccupant depuis la stabilisation relative du Tchad avec Idriss Déby. C'est donc l'Ouest qui est alarmant et qui demande de nouvelles approches. Les choses étaient plus simples il y a un an ou deux.
La situation n'est pas encore désespérée. Mais toute approche dans l'Azawad - et l'Azawag nigérien où opérait il y a quelques mois une Rébellion - qui ne se fonderait pas principalement sur une solution politique, et accessoirement seulement sécuritaire, ne changerait pas fondamentalement la donne. Il faut cesser d'alimenter la machine intérieure du désespoir pour isoler les terroristes et couper les passerelles qui se sont établies récemment entre eux et les nationalistes Azawadis et, éventuellement, Azawaguis. Il est bien difficile de croire que les Touaregs des deux régions n'aient pas les mêmes sentiments depuis toujours. Travailler comme si cette solidarité n'existait pas équivaut à retarder l'éclatement de la bombe, au moment le plus inopportun, peut être au milieu du dispositif.
Ceux qui s’agitent autour du lit du malade peuvent-ils vraiment croire qu’on peut pacifier le Grand Sahara de l’Ouest sans initier, en même temps, une solution durable du problème du Sahara Occidental (ex-espagnol) et sans impliquer les Sahraouis ?
Lorsque la confusion s'est installée il y a quelques années, dans le Grand Sahara de l'Ouest, la communauté internationale n'a trouvé débout que la Mauritanie, parce qu’elle est une terre saharienne par excellence et que ses hommes sont des Sahariens par excellence.
C'est la grande erreur des terroristes d'avoir jeté leur dévolu sur la Mauritanie et voulu en faire leur terre d'asile ou de substitution à l'Afghanistan : leur sahélistan. En cherchant à avoir un foyer dans le Grand Sahara, ils auraient dû éviter, soigneusement, de s'affronter à deux pays : le Tchad et la Mauritanie.
C'est pourquoi aussi on ne voit pas comment l'intervention militaire de la CEDEAO pourrait ne pas être désastreuse, dans l'univers incroyablement difficile du Sahara, sans que l'essentiel n'en soit confié à ces deux pays. Mais on ne voit pas, non plus, pourquoi ces deux pays, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, seraient engagés par une décision de cette organisation. Le Tchad n'est pas directement concerné et on ne perçoit pas la logique qui l'amènerait à engager ses hommes dans une guerre qui n'est pas sur ses frontières, alors que, périodiquement, des soulèvements intérieurs le secouent lui-même. Peut – il vraiment se passer d'une partie de ses forces?
Des combattants mauritaniens, éventuels, qui ne sont pas à l’ordre du jour, ne seraient aucunement motivés si le problème de fond de l'Azawad n'est pas isolé du problème du terrorisme islamiste et sa solution juste entrevue. Quels motifs auraient – ils pour combattre les guérilléros du MNLA ou du Front arabe, qui n'ont jamais fait de tort à leur pays, et dont les mauritaniens, dans leur majorité, regardent le sort avec pitié et compassion ?
La Mauritanie lutte, seule, depuis 3 ans, pour préserver son territoire et la sécurité de ses habitants. Le résultat est que l'abcès de fixation s'est déplacé. C'est désormais ailleurs. Nos voisins ont été victimes d'une lecture fautive des données de la fresque et de la compréhension qu'en se retranchant dans une stricte politique de l'autruche ils pourraient échapper au cyclone qui soufflait à leur porte.
Le problème n'est plus désormais celui de la Mauritanie, mais de toute la région et de la communauté internationale dans son ensemble. La Mauritanie redevient une partie parmi les parties, alors qu'elle était la seule à porter le fardeau de la lutte contre le terrorisme islamiste.
Dans ce jeu, elle n'est pas et n'a jamais été le maillon faible. Aujourd'hui la Mauritanie est déchargée, le fardeau est tombé sur la tête d'autres.
Durant cette campagne de notre armée, certains n'ont pas craint de toucher au moral de nos soldats qui donnaient leur vie pour que nous vaquions à nos affaires quotidiennes.
Cet état d'esprit est désastreux et le civisme élémentaire qu'on enseignait aux écoliers ne l'autorise pas, à plus forte raison le patriotisme que les hommes politiques devraient s'arracher pour mériter la considération et la confiance de leurs concitoyens.
Lorsque le succès à couronné l'offensive de notre armée, des voix se sont élevées même pour s'exprimer à la place des Maliens et déplorer notre réussite. Cela dépasse l'entendement. Pourtant sans cette armée, à laquelle certains sont allergiques, il n’y a pas d'élections, il n’y a pas de partis, ni de boutiques, ni – plus grave – d'argent.
Quand les passions actuelles seront ravalées, seront oubliées, qu'on aura même regretté tout ce qu'on a dit et fait – c'est le destin de tout ce qui est sans mesure – et qu'on sera face aux moments implacables de vérité, tout cela coûtera cher quand cette balance politique invisible et impartiale, qui pèse sans relâche, rappellera ses comptes de manière péremptoire et irrévocable.
A suivre...
Par Mohamed Yehdih O. Breideleil