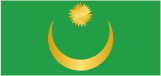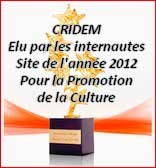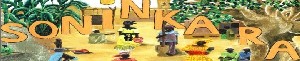13-08-2012 11:02 - La Mauritanie et l’Azawad (V)
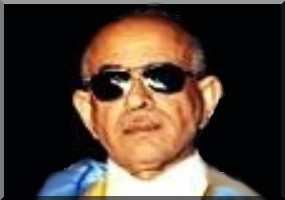
V- L’injustice et la misère.
Les terres que devait occuper Coppolani étaient beaucoup plus vastes que l'héritage qui nous est parvenu sous le nom de Mauritanie, puisqu'elles comprenaient le Sahara Occidental qui n'avait pas été encore concédé à l'Espagne et l'Azawad géographique, c'est-à-dire la zone des Maures.
Les intérêts et l'équilibre des puissances coloniales, d'une part, et les commodités d'accession aux terres intérieures et d'administration, d'autre part, en ont décidé autrement. L'essentiel du pays maure, finalement, a été divisé en deux moitiés presque égales.
Celle de l'Ouest, à laquelle on a trouvé en cours de chemin, un nom – Mauritanie – sera administré à partir du Sénégal, celle de l'Est sera administrée à partir du Mali.
Par bonheur pour la Mauritanie, une grave bagarre éclate dans le Hodh en 1940. Il s'avéra rapidement que le maintien de l'ordre ne pourrait être assuré au Hodh, à partir de Bamako. On procèda donc dans les années suivantes au rattachement des deux hodhs à la Mauritanie.
Les maures de l'Azawad, ne subissant par l'influence de Cheikh Hamahoullah, mais situés au foyer principal du Quadirisme, celui des Kounta Cheikh Sidel Mokhtar, on les laissa dans la dépendance de Bamako, n'étant pas concernés par l'agitation. D'ailleurs, les dirigeants hamahallahistes qui ne furent pas passés par les armes furent embastillés à Kidal et à Gao.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'histoire séculaire commune qui est une évidence, ni sur l'appartenance à la même société qui n'est pas vraiment un sujet de discussions. Pour les gens, l'appartenance de Cheikh Sidel Mokhtar à l'Azawad est en elle même suffisante pour rappeler l'unité rompue. Il ne manque pas de gens pour se tromper sur la dernière demeure du Grand Cheikh. Est-elle entre Akjoujt et Noudhibou, à Vask, ou à Oualata? Elle est simplement dans l'Azawad.
Et, en effet, Cheikh Sidel Mokhtar n'est pas n'importe qui, puisqu'il fut le maître de Cheikh Sidya, de Cheikh Al Ghadhi et Cheikh Al Moustaph, entre autre sommités de l'Ouest, et qu'il a rayonné de toute sa science sur tout le grand Sahara de l'Ouest, avant que celui –ci ne soit vu par les yeux des européens comme une ''mer sans eau'' où la vie est impossible et les distances interminables.
Bien avant le siècle de Cheikh Sidel Mokhtar, le 18éme, les échanges et les influences se faisaient dans l'autre sens et notamment à partir de Oualata. Mais les historiens considèrent aussi que Ouadane est à l'origine de la fortune culturelle de Tombouctou et que le célèbre Ahmed Baba At-Tomboucti a ses racines dans la vieille cité de l’Adrar. Le mystère de Ouadane s'éclaircit passablement.
La décadence et le déclassement de cette cité par rapport à ses voisines avait de quoi intriguer. Aucune attaque barbare n'est à l'origine de sa déchéance, une perte de vitalité pure et simple ne se conçoit pas sans facteurs agissants de départ, pour une cité dont on dit que dans une même rue, on pouvait compter 40 savants installés dont aucun n'avait plus rien à apprendre de l'autre.
Ouadane aurait donc transmis sa sève, aurait essaimé, émigré, trop tôt et trop loin.
On a de la peine, présentement, à réaliser qu’il était si facile d’établir des relations suivies entre Ouadane et Tombouctou. C’est parce que la conception du temps était différente. Le voyage d’une journée ou deux n’était pas considéré comme un voyage. Un voyage se dit quand on va d’une cité saharienne à une autre, ou à plusieurs autres.
Chiekh Sidya, avant d’aller dans l’Azawad, alla d’abord vérifier ce que Chinguetti, Tichitt et Oualata ont dans le ventre. Un long voyage se dit seulement quand on va au Caire et à la Mecque. On ne comptait pas le nombre de mois ou d’années qu’on a effectués hors du foyer, mais ce qu’on rapporte comme connaissances, livres et biens.
On voyait les choses sur une génération, et non sur quelques années ou quelques mois... Le temps était long et on travaillait pour l’éternité. Maintenant le temps est court, bien qu’il n’ait pas diminué d’une seconde, et on travaille au jour le jour. Rien de durable ne s’entreprend.
D’ailleurs Heidegger définit cette coupure dans la conception du temps :
« C’est au moment où l’homme est brusquement entré dans l’inquiétude de n’avoir plus le temps qu’a commencé la perte croissante du temps. Ce moment est le commencement des temps modernes ».
Les Maures ont pour voisins, à l'Est, les Touaregs avec lesquels ils coexistent dans l'Azawad, dans son acception politique nouvelle. Le monde Touareg devient de plus en plus dense et se prolonge au Niger au-delà de la vallée de l’Azawag et des montagnes de l'Aïr, jusqu'à la cuvette du Ténéré. Plus loin, c'est le Sahara de l'Est, quand commence le monde Toubou et la densité des Arabes Oulad Sleymane, ces Arabes chassés de Libye par les Turcs au 19éme siècle et qui ont essaimé au Borkou et au Kanem.
Mais on n'escamotera pas, parce qu'il n'est pas à l'ordre du jour d'un drame, le fait qu'à l'Est de l'Azawad, il y ait des Maures autochtones dans l'Azawag nigérien qui se déplacent naturellement avec leurs animaux et qui ont des villages et dont le chef porte le titre pompeux de ''Sultan des Arabes''. Ils coexistent, eux aussi, avec les Touaregs du Niger.
Dans l'Azawad au sens large, les touaregs furent de tout temps la force principale, bien que les Maures, force qualitative, se furent toujours imposer sur le plan spirituel et politique - Kounta et Cherifs d'Araouane – et que les Berabich, d'extraction Hassan, se firent respecter militairement. L'historienne Coquery – Vidrovitch souligne que la vielle cité de Tombouctou retrouve au milieu du 19éme siècle une certaine stabilité et fait briller son lustre spirituel sous « la direction efficiente, intelligente, des Arabes kounta, représentés notamment par Cheikh Al Bekkaye ».
Beaucoup de grandes tribus Touareg font remonter leurs origines à des ancêtres arabes. Les Kel Ansar qui sont les plus proches, se considèrent – comme leur nom l'indique – des Ansars. Les Ifoghas disent descendre des Chérifs du Tafilatet. Nous ignorons quels liens anciens existent entre la Tribu des Adnan et les Arabes du Nord : Moudhar, Rabiaa et Iyad. Toujours est – il que la langue écrite des Touareg, le Tifinagh, est une langue sémitique comme l'Arabe, le Syriaque, l'Araméen et leurs sœurs.
Lorsque les Européens se sont présentés à la fin du 19ème siècle, les Touaregs réagirent exactement comme les Maures, par une résistance dispersée mais farouche. Beaucoup d’entre eux, comme les autres habitants du Grand Sahara de l’Ouest, répondirent à l’appel de Cheikh Malaïnine, l’âme de la Résistance, et combattirent à ses côtés, ou avec Abidine O. Cheikh. D’autres jouèrent séparément.
Lorsque la ceinture de la colonisation s'est refermée, il y eut encore d'autres ceintures étroites, ces terribles frontières qui ignorèrent la société, l'histoire et les sentiments des hommes. Un bon jour, on apprit qu'il était interdit de nomadiser et de voyager au-delà de certaines lignes, qu'il faut cesser tout contact, toute relation, tout commerce avec les frères, les parents de l'autre côté. C'est la prison, la prison morale, à perpétuité.
C'est tout le sens de l'orientation qui change, un amendement porté aux points cardinaux, depuis des millénaires. L'Ouest n'est plus l'Ouest, l'Est n'est plus l'Est. Ils prirent d'autres noms bizarres et à peine prononçables : les noms artificiels forgés pour désigner les nouvelles colonies. Les choses apparurent aux contemporains comme une nouvelle fantaisie du colonialisme, une nouvelle injustice.
Le statu quo des frontières, fixé définitivement en 1945, après le rattachement des deux Hodhs à la colonie Mauritanie, resta en vigueur jusqu'aux indépendances africaines de 1960.
Cependant, en 1957, la France, consciente du caractère trop artificiel du rattachement du Sahara aux colonies de la Savane - on dit maintenant Sahel – qui y font face au Sud, conçut un projet qui regrouperait non seulement le Grand Sahara de l'Ouest, mais aussi le Sahara de l'Est et le Sahara du Nord, dans une même entité : l'OCRS. La seule colonie qui ferait intégralement partie de cette Organisation Commune des Régions Sahariennes est la Mauritanie.
L'OCRS eut son grand conseil où siégeait le représentant de la Mauritanie, l'Emir du Trarza, Mohamed Vall Ould Oumeïr. Le projet était trop ambitieux, dérangeait les intérêts des colonies de la Savane et surtout venait trop tard, en pleine guerre d'indépendance de l'Algérie et apparaissait comme un combat d'arrière - garde. Les populations de l'Azawad, de l'Azawag et du Tibesti –Ennedi – Borkou le saluèrent chaleureusement.
Seule, parmi les intéressés, la Mauritanie, qui y avait le plus d'intérêt, s'y opposa farouchement. Sidel Mokhtar O/ Yahya N'Diaye qui était la première personnalité de la Mauritanie d'alors - on a trop tendance à l'oublier – n'y voyait pas sa place et Mokhtar Ould Daddah, qu'il venait d'adouber, lui aussi, perçut, rapidement, que dans un ensemble aussi vaste ses ambitions futures seraient anéanties.
Les représentants des autres régions sahariennes étaient en général peu instruits, peu introduits, n'entrevoyaient pas tous les enjeux d'arrière –fonds et leurs voix furent inaudibles et ne surent défendre ce projet qui, s'il était colonialiste, ne l'était pas plus que la loi – cadre qui donnait un gouvernement local présidé par le Gouverneur de la colonie et comprenait, pour la Mauritanie, Compagnet Maurice, comme Ministre des Finances et Salette, comme Ministre de l'Equipement.
Finalement l'Assemblée Nationale Française se réunit en séance plénière pour décider définitivement du sort de l'OCRS. Un concours de circonstances fit que le Gouvernement français était représenté par le Ministre d'Etat à la Présidence du Conseil, Félix Houphouet Boigny – oui, le même, de Côte d'Ivoire – qui était de toute évidence le représentant des colonies de la Savane qui allaient être amputées des régions sahariennes. L'Assemblée, encouragée par le représentant du Gouvernement, enterra donc sans difficulté la dernière tentative de donner aux populations du Grand Sahara un cadre qui serait le leur et dans lequel elles se sentiraient à l'aise.
On connait trop bien la longue guerre civile du Tchad, déclenchée parce que le Gouvernement de ce pays avait ôté de la Constitution la langue arabe. Les rébellions et les répressions successives au Niger et au Mali sont moins connues.
Le Mali connut sa première rébellion en 1962 – 64. Elle était dirigée par les chefs de tribus et les notables traditionnels, Touaregs et Maures confondus. Ceux que le Mali n’a pas capturés, furent livrés par Ben Bella. Pas un n'en réchappa, ils furent passés par les armes. Le seul qui resta vivant fut l'Emir des Kal Ansar, Mohamed Aély. Il s'était réfugié au Maroc et vécut pratiquement centenaire. Il est mort, il y a seulement quelques années. On dit que l'un des principaux dirigeants actuels du MNLA, Med Ag Najem est le fils de l'un des pendus de 1964.
Les causes immédiates de la rébellion des années 1960 étaient que, à la place des militaires français, intelligents et adroits, l'Azawad ait été occupé par les militaires maliens, se comportant en pays conquis, dans toutes les sphères de la vie des gens, privée et publique, pouvant aller jusqu'à dépouiller les habitants de leurs derniers biens matériels. C'est un colonialisme sous – développé, déguenillé, qui n'a rien à offrir, en contrepartie de sa domination, que la brutalité et la misère.
A suivre
Par Mohamed Yehdih O. Breideleil