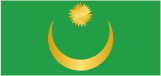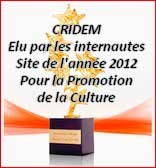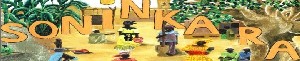12-08-2012 00:34 - L’émirat de l’Adrar Pierre Bonte.
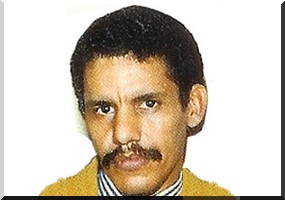
Les éditions Jousour viennent de traduire et de publier en arabe l’ouvrage de l’anthropologue français Pierre Bonte intitulé L’émirat de l’Adrar (Mauritanie). Harîm, compétition et protection dans une société tribale saharienne.
Cette publication illustre le projet de la maison d’édition de permettre à un public arabophone, académique et universitaire prioritairement, l’accès à des travaux en français, peu accessibles au lecteur mauritanien, comme les récits de voyageurs, ou qui ont fait date dans le développement des recherches en sciences humaines et sociales en Mauritanie.
Les travaux de Pierre Bonte sur la société mauritanienne baydhân sont déjà connus du public mauritanien et une courte synthèse en a déjà été présentée en français et en langue arabe, à l’initiative de la coopération française.
Le présent ouvrage, publié en français en 2008 reprend une partie de sa thèse monumentale, qui date pour sa part de 1998, mettant ainsi à la disposition des lecteurs une étude approfondie des conditions de formation et de fonctionnement de la société baydhân telle qu’elle se présente dans le cadre de l’émirat de l’Adrar, l’une des institutions politiques originales qui se sont constituées au XVIIIe siècle dans l’espace mauritanien actuel, constituant jusqu’à nos jours une des provinces historiques et administratives de la Mauritanie contemporaine.
Cette étude s’inscrit dans l’histoire en évoquant l’évolution de la société adraroise depuis la formation de l’émirat et les conditions de celle-ci. La notable absence de travaux historiques antérieurs sur cette région incitait l’auteur à développer cette approche. Il ne s’agit pas cependant d’un travail classique d’historien dans la mesure où la recherche s’appuie essentiellement sur la riche tradition orale recueillie à l’occasion de multiples interviews depuis le début des années 1970, près d’un millier !
D’autres travaux devront encore être mobilisés pour compléter notre connaissance de cette histoire, en particulier les documents écrits, historiques et surtout économiques et juridiques, qui sommeillent dans les archives familiales. La seule tradition orale fournit cependant une abondante documentation qui s’épuise avec la transformation des modes de vie peu favorable à la transmission de la parole. Pendant qu’il est encore temps d’autres travaux de cet ordre devraient être menés dans d’autres régions du pays.
Anthropologue, Pierre Bonte s’intéresse cependant avant tout aux faits sociaux, aux particularités de ces institutions tribales et politiques caractéristiques de l’Ouest saharien. La tribu, principale groupe d’affiliation des individus et source première des identités, retient particulièrement son attention. Il en propose une lecture moins « archaïsante » que celle généralement attachée à l’usage de ce terme dans la tradition scientifique occidentale.
Il s’appuie à cette fin sur une nouvelle approche des analyses du grand penseur Ibn Khaldoun qui au-delà de la vision formelle et fixiste du nasab (généalogie liant à l’ancêtre apical) et de la casabiyya (solidarités masculines résultant de ce lien généalogique) souligne l’esprit de compétition propre aux dynamiques tribales et les capacités de celles-ci de se déployer sous forme de chefferies ou d’Etats. Cette compétition trouve ses fondements dans le respect de l’intégrité sexuelle et matrimoniale des femmes et la défense de l’intégrité physique des hommes qui s’exprime dans la notion de harîm (droits exercés et interdits respectés par un individu ou un groupe) et en termes d’honneur. Les fortes hiérarchies statutaires et politiques que présentait la société baydhân trouvent là un début d’explication.
La formation de cette société baydhân relève cependant aussi des contingences historiques. Elle résulte d’abord de la rencontre et de la conjonction des populations sanhâja et des tribus arabes BaniHassân qui occupent successivement l’espace pastoral ouest-saharien. Cette conjonction a vu la transformation de la plupart des traits de la culture sanhâja, telle la définition de la parenté et les rapports de genre, masculin/féminin, comme une conséquence de l’islamisation et de l’arabisation qui privilégiera le rattachement à des ancêtres arabes, historiques comme cUqba, conquérant de l’Afrique du Nord, ou légendaires comme le Sharif Bûbazzûl.
Certains traits substitueront cependant comme le statut reconnu à la femme dans la société baydhân et la langue berbère, le znâga, restera parlée jusqu’à nos jours. Ce terme, sans présenter de connotation ethnique particulière, servira ensuite à rendre compte du statut de protégé d’une partie des tribus qui se définit dans des conditions diverses. L’établissement ancien d’un islam sunnite malékite est un autre facteur historique qui favorisera la conception locale d’une société tribale où n’existe pas en permanence un Etat légitime islamique. Les fonctions religieuses, au prix d’ajustements coutumiers (rôle de la jamaca, généralisation de la diya, etc.) permettront de penser la référence islamique dans un contexte de sayba, d’absence de l’Etat, et justifieront la place occupée par les tribus zawâya qui monopoliseront l’économie et les échanges.
La formation de l’émirat de l’Adrar implique l’effet de ces déterminations historiques mais s’inscrit aussi dans la dynamique tribale. L’évolution et le développement des rapports de protection ont accentué la stratification sociale et favorisé la constitution de nouvelles hiérarchies politiques, plus que de simples chefferies, mais sans présenter tous les attributs de l’Etat, si l’on peut fixer un point zéro de l’origine de celui-ci. La formation de l’émirat traduit aussi les mécanismes d’élargissement des alliances intertribales sous une forme factionnelle, mobilisées en fonction d’objectifs politiques instables, et duelle, aboutissant à l’établissement de deux factions antagonistes comme les illustrent les leff maghrébins.
Ici, s’opposent, à l’occasion des successions, pouvoir et dissidence, source de troubles politiques que maitrisent en d’autres périodes les grands émirs (Ahmed cAydda, Ahmed uldMhamed) habiles à manipuler ce jeu des alliances.
Cette analyse de la formation et de l’évolution de l’émirat de l’Adrar n’épuise pas le thème de l’étude de la société baydhân. Ailleurs, dans l’est et au nord, la même structure tribale a connu d’autres formes d’organisation politique, d’autres destins historiques. Les travaux de Pierre Bonte apportent une contribution significative, cependant, à cette étude et méritaient d’être mis à la disposition des lecteurs arabophones qui y trouveront non seulement une source documentaire riche et exhaustive, mais aussi des éléments d’une problématique et d’une méthodologie qui ne peut que les aider à développer leur propre réflexion.
L’émirat de l’Adrar, Pierre Bonte
Traduit par Mohamed OuldBouleiba.
Docteur ès lettres de L’université de la Sorbonne.