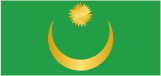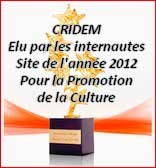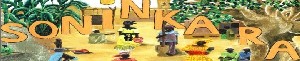09-08-2012 16:39 - La Mauritanie et l’Azawad. (2)
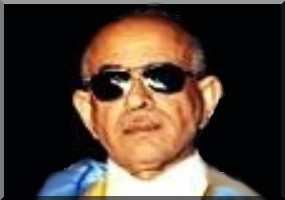
II – Ceux qui crient.
De toute façon la «délicatesse est un don de la nature» dit Pascal. Mai on pensait jusqu’à très récemment que le premier devoir de l’homme politique est de savoir se modérer, se fixer des limites. Ce n’est pas parce qu’on nous a tendu un micro, ou parce qu’on a un mandat électif ou jouit d’une immunité ou parce qu’on ne craint plus de se retrouver en prison pour longtemps, comme il y’a quelques années, qu’on doit proférer toutes les insultes intériorisées ou refoulées. On crie même au haut parleur.
L’invention du haut parleur visait à éviter à l’homme de crier. D’ailleurs l’argument, c'est-à-dire l’idée destinée à convaincre, n’a pas besoin d’être crié. Il ne vise pas l’oreille, il s’adresse à l’esprit. L’homme qui crie n’est pas sérieux.
Celui qui croit que dans la vie, tout est bon à articuler même en bien, à plus forte raison en mal, est fait pour autre chose que la politique.
De plus, tout ce qui n’est pas interdit, n’est pas permis.
Cheikhou Amadou, le fondateur de l’empire peulh du Macina, était un homme pieux, droit et désintéressé des biens de ce monde. Il gouvernait par le truchement d’une assemblée d’Oulémas d’une soixantaine de faghihs qui siégeait en permanence à ses côtés et décidait de tout. Comme ils étaient rigoureux et rigoristes – ils appliquaient le système qui était en vigueur à Médine au temps des premiers Califes – pour eux les choses étaient soit interdites, soit permises. René Caillé qui traversa le Sahel et le Sahara vers 1824-1828 dit que les «peulhs musulmans sont plus fanatiques encore que les maures».
Comme Cheikhou Amadou ajoutait l’intelligence à ses autres qualités, il savait que les choses sont moins simples que ne le présentent les Oulémas. Il voulut leur ouvrir les yeux. Un jour, il ordonna qu’on fit cuire de la bonne viande, en présence des Oulémas, mais y ajouta des margouillats, des sauterelles et d’autres insectes. Quand le tout fut prêt, on le présenta aux Fagihs et Cheikhou Amadou leur demanda de manger. Ils répondirent qu’ils ne mangent pas ces choses. Le Cheikh leur dit : pourtant ces choses ne sont pas interdites. Ils répliquèrent nous le savons. Donc, conclua t’il, il y a des choses qui ne sont pas interdites et qu’on ne doit pas faire et nous en tiendrons désormais compte à l’avenir.
La politique – la politique contenu – fait partie de ce qu’il y a de sublime dans la production intellectuelle des hommes. Il y a sans doute au dessus, la philosophie, mais à un certain niveau elles se rencontrent. «Dans la politique se résume toute la philosophie» dit Gramsci, et Marcuse va plus loin et inverse : «la politique devrait analyser le contenu des concepts philosophiques pour appréhender une réalité qui ne soit pas mutilée». C’est l’Humanisme de la Renaissance qui a fait cette admirable jonction, en faisant de l’homme la valeur suprême. L’idéologie est venue par la suite, bien après, donner aux principes politiques leur cohérence, coordonner entre les buts et les méthodes, rendre la fin et les moyens congruents.
On cite souvent l’économie science à coté de la politique. C’est un non sens. L’économie est une servante du système social dominant. Le droit aussi est un simple serviteur de ce système. La politique est une fée. Sa place dans le ciel des connaissances, se situerait dans la constellation où se trouvent, pas pour leur valeur, mais pour leur autonomie, la poésie et, peut être, la magie.
Une université qui accorderait des diplômes en poésie et en magie frôlerait le ridicule. Pourtant, on apprend et on enseigne la poésie. Mais il serait infiniment plus avantageux pour un futur poète d’avoir côtoyé beaucoup Nizar Ghabani et Adonis ou de s’être familiarisé avec leur poésie que d’aller au cours de poésie.
On apprend aussi et on enseigne la magie. Ibn Khaldoun a appris la magie et il donne quelque part, dans ses écrits, quelques leçons de magie. Mais il n’était pas magicien.
Un apprenti magicien ou sorcier a besoin d’un gourou pour éviter le danger proverbial qui le guette : déclencher des événements dont il n’est pas maître et qui peuvent l’emporter. C’est le genre d’aventure dont se méfiera, avant toute autre préoccupation, le politique en herbe, à plus forte raison le politique accompli.
Le politique est rigoureusement tenu par une double bride : se garder de l’aventure, ce qui n’est pas la même chose que l’audace – Clausewitz dit : la plus grande audace peut correspondre à la plus grande sagesse – et s’en tenir à l’étique qui fonde la politique.
Le politique est sans pareil quand il travaille avec passion, corps et âme, comme s’il voulait récupérer son propre domicile confisqué par autrui, ne ménageant ni son temps, ni son intérêt personnel, au détriment de sa vie privée et au besoin de sa liberté, uniquement pour améliorer le sort des millions de quidams misérables, inconscients de leurs droits, pétris de fatalisme, et sachant une seule chose : qu’une injustice irrémédiable, descendue du ciel et exécutée avec persévérance et exactitude par les mortels, les frappe. C’est le sommet de la générosité. On a encore rien trouvé de si haut. C’est plus que l’élargissement d’un condamné à mort auquel on dit: «tu es libre, tu peux partir».
Une telle chose ne peut être mal traitée que dans une société où la philosophie est bannie et la valeur de l’homme niée.
Une matière qui requiert tant de ressources de l’esprit : rigueur de la raison, profondeur de la réflexion, finesse dans l’action et, du cœur : confiance en la bonté foncière et la perfectibilité des hommes, respect de l’autre, désintéressement, modestie, peut-elle, entre nos mains, se muer en cirque produisant des «hommes sans qualités» ? Tocqueville soutient que dans certains pays où la charpente sociale avait pris feu «la société politique tombe en barbarie dans le même temps que la société civile achève de s’éclairer».
Même en temps de guerre, les hommes ne se délestent pas toujours de leurs valeurs élevées, de ce qui fonde leur existence, de ce qui fait d’eux ce qu’ils sont, de leur légitimité en quelque sorte. C’est bien au nom d’une certaine idée de soi, supposée reconnue par les autres, que l’on prend des positions ou entreprend des actions. Si cet acquis tacite n’existe pas ou plus ou est gravement chahuté par un comportement rédhibitoire, on est délégitimé. On n’a pas besoin de déclarer forfait. Le forfait s’insinue de lui-même dans tous les esprits et c’est encore plus patent qu’une déclaration en bonne et due forme.
Au cours de la Grande Révolte Arabe, déclenchée par le Chérif de la Mecque, en 1916, pour libérer les Arabes du joug des Turcs, l’Emir Fayçal, fils du Chérif, apprit que la garnison turque de Médine, qu’il assiégeait, manquait cruellement de tabac. Lui-même, grand fumeur, ne supporta pas ce supplice moral infligé à ses ennemis. Il fit charger quelques chameaux de cigarettes et les envoya aux Turcs avec ses excuses.
Lors de la guerre du Rif de Abdel Krim, un soir dans la montage, un officier français recevait en pourparlers une délégation de la rébellion nationaliste. Subitement son QG fut attaqué par un autre groupe de la rébellion qui n’était pas informé des pourparlers. L’officier demanda aux rebelles de s’en aller. Ceux-ci répondirent qu’ils étaient ses hôtes et que leur honneur ne leur permettait pas de l’abandonner dans une pareille situation. Ils combattirent donc leurs frères, sauvèrent le poste de leurs ennemis et regagnèrent leur maquis.
Durant les campagnes successives du génial Charles XII de Suède contre la Russie, le tsar Pierre le Grand rassemblait toutes les troupes qu’il pouvait lever et les portait au devant du Roi de Suède sur un vaste front et attendait l’assaut de son fougueux adversaire. Celui-ci perçait à chaque fois la ligne mince qu’on lui opposait, lançait ses troupes dans la brèche et enroulait l’armée russe. A chaque fois, la destruction presque totale du défenseur s’ensuivait.
Le Roi envoyait ses prisonniers en Suède, à l’exception des généraux qu’il retournait au tsar avec ses compliments, car il eût été dommage, disait-il, de le priver pour la prochaine campagne d’un haut commandement aussi persévérant. Après tant de revers, l’un de ces généraux suggéra à Pierre le Grand que ses échecs répétés tenaient peut être à son ordre de bataille et qu’on pourrait avantageusement substituer le principe des centres de résistance à celui de la ligne continue. La suggestion fut acceptée.
L’assaut suédois se brisa contre les redoutes russes. La contre attaque tailla en pièce l’armée de Charles XII. Réunissant les généraux ennemis faits prisonniers au soir de la bataille, cette fois-ci Pierre le Grand levait son verre «aux généraux suédois, nos maîtres dans l’art de la guerre».
La victoire et la défaite se sont faites dans la grandeur. Chacun des deux adversaires en reconnaissant la valeur de l’autre et par un geste de haute noblesse, s’est élevé en dignité.
Ces gestes n’impliquent aucune marque d’amitié, ni aucune volonté de paix. Dans l’inimitié extrême, ces deux hommes évitaient ce qui pouvait les rabaisser, s’ingéniaient à prouver qu’ils sont dignes de leur rang.
Les Oulad M’Bareck, une fois, dit-on, s’abstinrent d’attaquer leurs ennemis, parce que ceux-ci n’avaient pas encore porté leurs pantalons, bien qu’ils fussent à portée de leurs fusils. Les Ouald M’Bareck donnèrent leurs dos aux ennemis pour leur permettre d’achever de s’habiller correctement. Ils craignaient que cet opportunisme n’entachât leur réputation et qu’une rumeur malvaillante ne courût derrière eux pour la postérité. Mais qui, aujourd’hui, regarde si loin pour sa réputation ?
L’exagération en politique se conçoit sur le plan des principes. Dans certaines circonstances, elle peut être une vertu. C’est ce qu’on appelle l’extrémisme. Il est fortement déconseillé à droite. A gauche, il est tolérable parce que la raison et l’éthique ne le désertent pas. Personne n’est plus extrémiste que Trotski, sur le plan des principes. Mais rares sont ceux qui égalent son éthique politique. Che Guevara est un autre digne représentant de l’extrémisme de gauche avec son humanisme révolutionnaire, de même que Marcuse avec sa théorie critique radicale.
L’extrémisme de gauche dans les méthodes s’appelle l’infantilisme. Il mène généralement à la catastrophe ou à l’impasse. L’extrémisme de droite dans les méthodes, s’appelle le fascisme. Sa connotation péjorative est déjà solidement établie.
Les outrances verbales ne se rattachent pas vraiment à une école, mais s’il faut leur trouver une filiation ce ne pourrait être que le fascisme qui, dans son histoire, en a le plus abusé. Il est difficile en tout cas de leur trouver des attaches dans la démocratie véritable, telle qu’elle s’est établie et généralisée en Europe au début du siècle dernier, après la chute des empires. Ce qui caractérise cette démocratie – là, c’est la modération. Sans la modération on ne peut pas avoir de démocratie. On est simplement dans un intermède entre deux dictatures : celle qu’on a fui et celle vers laquelle on tend, avec la minutie de l’orfèvre et la patience de Jonas.
La démocratie est garantie par deux choses : une classe politique consciente qui a fait son aggiornamento, sa reconversion, a tourné définitivement la page de la violence verbale ou physique et une population éclairée qui a pris goût aux, ou choisi, les méthodes douces et qui accorde sa confiance définitivement à la classe politique régnante et ses approches, parce qu’elle le mérite. C’est autre chose que l’attachement à son propre leader. Cet attachement à son leader ne préjuge de rien, n’est pas synonyme de confiance en la classe politique. L’attachement et la confiance des citoyens, dans la République de Weimar, à Adolphe Hitler ne signifiait pas confiance dans la classe politique bien au contraire. C’est de là qu’est venue la ruine de cette république idéale dans ses textes et dans son fonctionnement formel.
On peut ne pas voter pour un dirigeant mais on a confiance à lui en ce sens qu’on le considère dénué de vindicte ou de mauvaise foi – mamoun char. C’est tout le problème : mamoun char.
Les idées de ceux qui se définissent, ou sont définis, comme une opposition radicale se perdent dans le flot de paroles excessives, dans l’à-peu-près, dans les slogans. Ainsi, quand ils ont abordé un problème essentiel pour la population, le plan d’aide aux éleveurs, ce qu’ils ont dit de juste et d’utile s’est perdu dans le tout - venant.
Plus grave, le slogan central de chute du régime en place, sous la bannière duquel ils travaillent, est complètement en dehors des réalités. Rien dans les conditions subjectives ne permettait de l’atteindre et les conditions objectives ne le laissent pas entrevoir. Sans doute, les plus avertis en théorie politique – il y a des moments où le bricolage et l’artisanat politiques deviennent indigents – ont été tenus à l’écart ou n’ont pas été écoutés lorsqu’il a fallu élaborer ou définir ce slogan.
C’est toujours la même chose, les voix de ceux qui sont sérieux par nature ou par formation ou par leurs idées sont couvertes par les autres et dans la cacophonie on n’entend que ceux qui crient.
On a placé la barre très haut. L’inconvénient est que, quand on n’atteint pas l’objectif, ce qui arrive est très grave politiquement. On barre la route de l’avenir et aucun objectif, même réaliste, ne sera plus pris au sérieux, ni véritablement considéré comme tangible. Cet objectif constitue donc un véritable danger pour l’opposition. C’est la fameuse pierre dont parle Mao Zedong, le grand guide de la Chine moderne.
Mao dit que la force qui n’est pas en harmonie avec son temps se saisit des deux mains de la lourde pierre de l’injustice et la soulève péniblement. Elle se donne pour devoir de la porter à son plus haut période. L’amenant au niveau de la tête, ses bras, épuisés par l’effort, la trahissent et n’ont plus la force de maintenir le fardeau à ce niveau, ni de le poser avec maîtrise. La pierre échoit immanquablement et tombe sur ses pieds. Voilà le danger.
Si les gens ont préféré la démocratie et sont heureux de s’y trouver c’est bien parce qu’elle est considérée comme meilleure. Ils la présument meilleure parce qu’elle est le règne de la liberté, qu’elle est consubstantielle à la justice et qu’elle va permettre de résoudre les problèmes quotidiens d’une manière fluide et efficace, disons automatique. Sans ce dernier qualificatif on ne se rapprochera pas de la compréhension des citoyens.
Mais avec toutes ces choses réunies et d’autres aussi importantes, si on s’installe dans un maquis procédurier, politique et juridique, visant l’obstruction, s’il n’y a même pas d’accord sur l’essentiel – la constitution, les lois, les élections, les intérêts supérieurs du pays, qui a le droit de décider – si plus rien, ni personne n’est respecté, si, quand on veut traiter les problèmes du pays on s’accroche à l’accessoire, si on maintient le pays dans une alerte permanente sans objet et sans raison, si l’énergie et l’attention des responsables (officiels ou non) est accaparée par l’insignifiant et l’inutile, alors la démocratie prouvera son inefficacité, qu’elle est même nuisible, que c’est une méthode de gouvernement inadaptée et personne ne voudra plus y rester un jour de plus et qu’il faut retourner à son contraire.
Nous inaugurerons alors une nouvelle ère d’incertitudes, riche en ambiguïtés. Il est difficile de croire que le pays peut supporter indéfiniment le blocage et le chantage à l’étranglement.
C’est ainsi que la République de Weimar est morte, vertueuse et belle, mais faite seulement pour un personnel de gentlemen de l’esprit. Le travail de sape des scélérats lui a substitué exactement son contraire avec l’assentiment enthousiaste – dans les urnes et dans les rues – d’une population excédée, réclamant qu’on se mette au travail et qu’on soit sérieux. Le drame est que le personnel de Weimar était constitué de gentlemen de l’esprit, mais ils ne pensaient pas que des agissements secondaires, même s’ils s’accumulent, l’attentisme devant le danger, l’immobilisme face aux problèmes de fond, l’inconscience de parlementaires byzantins, l’incapacité à déceler à temps et à isoler les anti-démocrates, pouvaient mettre en péril tout un système, à l’origine voulu par tout un peuple, et produire le monstre du nazisme.
En Allemagne, la démocratie était bien enracinée, le peuple cultivé, l’intelligentsia brillante, mais la classe politique n’était pas l’égale du pays. Chez nous, la démocratie est venue sur un brancard, octroyée. Aucune force ne l’a imposée, ni même sérieusement revendiquée.
Du temps du parti unique, une multitude d’opposants prêchaient toute sorte d’idées et luttaient pour une infinité de revendications, mais pas la démocratie pluraliste. Le régime d’alors la considérait comme une idée et un principe criminels au regard de la constitution et des lois et une traîtrise visant à saper l’unité du peuple mauritanien. Il était moins dangereux de prêcher le marxisme-léninisme ou le baathisme.
En vérité, quelques personnalités, se comptant sur les doigts d’une main, n’ont jamais cessé de croire que le pluralisme politique était la meilleure méthode de gouvernement. On en connaît le regretté Hamoud Ould Ahmedou, ancien Président de l’Assemblée Nationale, Cheikhna Ould Mohamed Laghdaf, ancien Ministre des Affaires Etrangères, Ismail Ould Amar, le fondateur de la SNIM, Ahmed Ould Sidi Baba, ancien Ministre et le regretté Ba Mamadou Samba Boly, ancien Président de l’Assemblée Nationale. Il n’y avait pas foule. Mais ces personnalités n’avaient jamais pu digérer le principe du parti unique.
A suivre
Par Mohamed Yehdih O. Breideleil