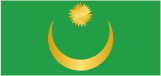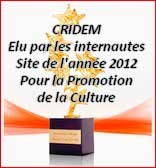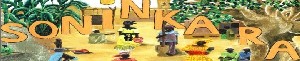08-08-2012 14:51 - La Mauritanie et l’Azawad : L’animal anti-politique.
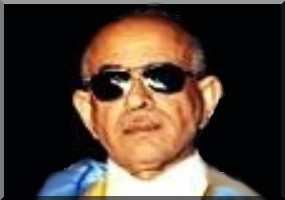
Lorsque Coppolani a été chargé de coloniser la Mauritanie, il a d’abord commencé par débarquer dans l’Azawad. Curieuse stratégie aujourd’hui. Il n’était cependant pas dans son esprit de conquérir la Mauritanie à partir de l’Est. S’il était coquin, il n’était pas nigaud et il faut être l’icône immortalisée par notre littérature orale, Teyba, pour le penser.
On sait que la célèbre douairière, jugée si sage par son entourage qu’elle devint chef de tout un campement, ordonna un jour, pour attraper les corbeaux, d’installer une solide haie de branchages d’arbres tout au tour des agiles volatiles.
Dans la longue histoire mouvementée du grand Sahara de l’Ouest, rares, très rares, ont été les mouvements de conquête d’Est en Ouest. Le mouvement des hommes s’est toujours fait du Nord au Sud ou de l’Ouest vers l’Est.
Exceptionnellement, quelques influx se sont faits du Sud au Nord : le mouvement almoravide de Youssef Ben Tachefine, le fondateur de Marrakech, qui réunit dans un même empire, l’essentiel du Maghreb et de l’Andalousie, et le mouvement de Cheikh Malainine qui proclama une éphémère royauté, également à Marrakech.
Mais c’étaient des appels du vide au Nord, qui nécessitait d’être comblé. Les Almoravides voulaient remédier à l’effritement du royaume des Idrissides et à l’anarchie qui s’en suivi et Cheikh Malainine à la défaillance des Alawites, face à l’avancée des Français.
Hélas, Cheikh Malainine venait trop tard dans un contexte déjà désespéré, après la conférence d’Algésiras où le consensus européen s’était établi et l’Allemagne et la Grande Bretagne avaient levé toute hypothèque à l’occupation du Maroc par la France.
Le discours du Kaiser Guillaume II, l’Empereur d’Allemagne, à Tanger en 1905, avait éveillé un espoir dans la région, d’autant plus que le Sultan Moulaye Abdel Aziz et Cheikh Malainine étaient tous les deux favorables à son pays. Mais les Allemands n’excellent pas en politique. Ils dédaignent, ou ils dédaignaient en tout cas, la politique. Les esprits distingués se destinent à la philosophie ou aux sciences ou à l’Armée. Ils ont malgré tout produit le redoutable Bismarck et le remarquable Willy Brandt.
Coppolani ne pouvait pas venir de l’Est. A partir de quelles bases ? Avec quelles forces sécuriser des lignes de communications et d’approvisionnement aussi longues et assurer ses arrières dans une zone aussi hostile. Coppolani ne pouvait venir que de là où il est venu, du Sénégal où les français sont solidement installés depuis au moins Schmaltz, c'est-à-dire près d’un siècle.
Mais le sac que devait remplir Coppolani est troué de deux côtés : à l’Est et au Nord. Le sac est, généralement, fermé du côté où il y’a la mer et du côté où, au-delà de la frontière, il y’a une population autre. Même une montagne, fut-elle l’Himalaya, ne ferme pas le sac. Elle peut même être une source d’inquiétude. Et un fleuve n’est rien. On ne le rappellera jamais assez, Clausewitz dit : «les exemples d’un fleuve efficacement défendu sont assez rares dans l’histoire».
L’ouverture du Nord, Coppolani n’avait pas la ressource de la scruter, c’est un canon de fusil: on y regarde une fois, pour mourir. De l’ouverture de l’Est, il fut relativement satisfait. Il parcourut une région qui est semblable physiquement et humainement à celle qu’il projette d’envahir.
Dans sa randonnée, il passait insensiblement de l’Azawad au Hodh et inversement sans que rien ne l’avertit. Il noua quelques relations, contracta quelques conventions hâtives, diffusa sa propagande sous toutes les tentes et notamment que la France respecte l’Islam et, ce qui est plus incongru pour la «grande fille de l’Eglise», qu’elle est l’amie des musulmans.
Comme gage de ses dires, il distribua généreusement sur son passage une grande quantité du livre de louanges et de grâces d’Al Jazouli, le livre de chevet de nos grands-mères, le fameux Dalil El Khairatt. C’est une manière adroite, pensait-il, d’aborder une société musulmane figée depuis treize siècles. Mais l’autre face, la société nomade, est plus complexe. Il découvrit que dans cette dernière la munificence est au sommet des valeurs.
Il n’avait pas pris ses dispositions pour une telle bienfaisance. Ça ne sera que partie remise, il veillera à ce que cette lacune ne se renouvelle pas quand il abordera les Maures à partir de leur autre extrémité, venant cette fois-là de Saint Louis. Tout cela met utilement en situation et donne les effets de dégradé pour la construction du projet qui reste à l’état virtuel et pour lequel il accumule lentement et laborieusement des pierres et du mortier. C’était la manière de Coppolani de mettre la Mauritanie en perspective à partir de l’Azawad et une preuve, ancienne d’un siècle, que toute politique concernant le devenir de notre pays ne peut ignorer l’Azawad.
Pourtant, les dirigeants successifs de l’Etat Mauritanien, qu’ils aient gouverné pendant vingt ans ou quelques années seulement, ont ignoré systématiquement pendant quarante cinq ans cette région et cela, à lui seul, nous renseigne suffisamment sur leurs mentalités, leurs capacités et l’ampleur de leur vision. Ni la puissance du facteur territorial de contiguïté, ni l’omniprésence du facteur d’homogénéité sociale, n’a compté pour ces dirigeants intraitables dans l’erreur.
Ils savent mieux que quiconque et ne demande l’avis de personne. Chefs d’Etat, ils croient s’amoindrir et perdre considération en s’entourant de l’avis de gens qui ne sont pas de leur rang. Par malheur, ils n’ont pas de collègues ici, ils sont donc condamnés à s’emmurer et à la surdité perpétuelle jusqu’au jour où éclate le tonnerre. Dans l’ancien Japon, les puérilités de l’étiquette défendaient le Prince - mais c’était un Dieu - contre le contact des roturiers.
Il a fallu le terrorisme pour nous éveiller à l’Azawad. Nous le découvrons comme s’il était frontalier de la Mongolie et qu’il se soit subitement transporté à notre voisinage. On dirait qu’un mur qui nous barrait la vue et nous empêchait d’entendre s’est effondré avec la déclaration de l’indépendance de l’Azawad par le MNLA, le Mouvement National de Libération de l’Azawad.
La réalité de ce territoire, tout ce qui s’y déroulait, tout ce qui l’agite et l’a agité pendant 50 ans, les drames dont il a été le théâtre, les injustices et les oppressions dont il a été la victime depuis un demi siècle, sous nos fenêtres, tout cela nous le découvrons. Ce que disait G. Duhamel, à titre personnel, peut donc s’appliquer à un Etat ? «Parfois, parce qu’ils sont proches, d’infimes événements me cachent le reste de la terre. Le bruit menu dans la cuisine m’empêche, certains jours, d’entendre le pas des nations qui s’acheminent vers leur destin».
Nous avons été longtemps malades du Sahara occidental (ex-Espagnol) sans le savoir. Mais la pièce de théâtre permanente que jouait l’Etat nous empêchait d’en prendre conscience. Ce problème n’était pas et surtout ne devait pas être l’un de ses actes.
Les entités sociales, ou les formations sociales, si l’on veut, sont indépendantes de la conscience de leurs membres. L’interaction existe, mais elle est inégale. La formation met des œillères à ses membres et les mène à la cravache, mais contrairement à ce qu’on peut penser, pas de l’avant mais en laisse pour que personne ne dépasse, que le rythme soit celui des trainards, des attardés, de ceux qui pensent peu et craignent l’action.
La tradition, le conformisme et l’habitude sont les enfants chéris de la société et de l’Etat sans vision progressiste. Les individus influent. Mais leur influence est variable. Elle peut se faire après un siècle et n’intéresse que d’hypothétiques «générations futures», comme il arrive qu’elle veuille délivrer les vivants, alors elle prend les apparences de la folie et la réalité et l’âpreté du creusement d’un tunnel sous la montagne de l’Adrar.
Ceux, les premiers, qui ont façonné la vase dont est sorti la Mauritanie étaient du premier ordre : ils ont une infinie compassion pour les «générations futures» et une imperturbable indifférence vis-à-vis des vivants, de l’inégalité, de la misère, de l’injustice, de la domination et de l’incomplétude de la base de leur construction - pas dans le sens hypothéticodéductif mais physique.
Mais les déficiences que l’Etat inhibe sont prégnantes dans la société, elles ne s’éliminent pas à volonté, la société et les individus les ressentent comme des malaises ou des maladies sans symptômes discernables.
Dans ce genre de contextes pathogènes, rien ne se résout, tout s’accumule, rien n’avance. Quand on décide de faire mouvement on s’aperçoit toujours avec retard qu’on est engagé dans une impasse et l’effort pour revenir au point de départ est plus éprouvant et plus déprimant que l’offensive initiale. Le résultat est le scepticisme généralisé, le manque de confiance en la réussite de toute entreprise, de toute idée et la défiance à l’égard de tous ceux qui s’accrochent à un idéal élevé. C’est en d’autres termes la paralysie.
Tant qu’on n’a pas remédié aux maux initiaux ou au mal originel, on restera égaré, ou victime de la somnolence, ça poursuit toute la vie. Napoléon soulignait que la bataille de Waterloo, qui l’avait perdu, avait été perdue en Inde au siècle précédent par un veule Louis XV. Qui relèvera les causes lointaines de nos batailles perdues ?
Notre «mal au Sahara occidental» (ex-espagnol) certains d’entre nous, il est vrai peu nombreux, s’en sont rendus compte en 1970 lors du mouvement de Zemla. L’Etat, lui, a préféré continuer à l’ignorer et à l’approcher par là où il ne fallait surtout pas, comme un problème de décolonisation anonyme, comme s’il concernait la Papouasie – Nouvelle Guinée.
C’était justement en 1970 qu’il fallait déclencher la guerre pour libérer le Sahara du colonialisme espagnol. La face de la région entière en aurait été changée.
Supposons seulement que le millier de morts et le rapport correspondant, de 2 à 3 fois, de blessés avait été pour la libération du Sahara, le pays aurait été aujourd’hui différent et infiniment meilleur et surtout notre moral ne serait pas le même.
C’est en 1970 que nous avons raté l’affaire du Sahara et que nous avons définitivement failli à notre devoir.
Il semble qu’en politique, il y’ait un seul instant optimal o