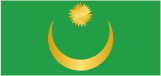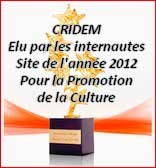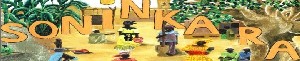26-02-2012 06:57 - Les désenchantés.

L’observation de notre société occidentale du XXI° siècle révèle, selon le philosophe Cornelius Castoriadis1 , que « l’insignifiance » que « tout conspire à étendre » est « dans l’esprit du temps ». En effet, rentière des combats et des luttes pour la liberté, notre société apparaît aujourd’hui comme au repos, la garde baissée.
Le seul moteur dont on peut être certain de l’efficacité, semble résider dans l’appel à notre égoïsme, au sens d’Adam Smith, c'est-à-dire à la promesse de la conservation et de l’accroissement de nos avantages matériels. Aurions-nous trop bien compris les vœux de Tocqueville en faveur de l’égalité de nos conditions de vie que nous serions tombés dans la prophétie de Marx : « Accumulez, accumulez, c’est la loi et les prophètes » ?
Faudrait-il craindre alors un retour à un état de nature lockien, dans lequel nos propriétés, paradoxalement, nous asserviraient plus qu’elles ne nous libéreraient ?
Aujourd’hui, la spéculation sauvage, le pouvoir des multinationales et la gouvernance des actionnaires sont au cœur de la vertu des modernes, suggérant cette corruption de la cité que décrivait Aristote. Mais là où à Rome, la prééminence des intérêts privés se traduisait par d’incommensurables et inextinguibles conflits, force est de constater que les conflits des « Temps modernes », nourris d’appétits catégoriels d’individus dépassionnés, lorsqu’ils ne sont pas prématurément étouffés dans l’œuf, s’épuisent, se délitent.
C’est ce recul de la conflictualité sociale que déplore le sociologue Alain Bertho quand il parle d’une « nouvelle taxinomie sociale », observant la « désagrégation syndicale » dans le secteur privé ».2 . Le jeu des divers groupes d’intérêts et de pression, mû par la multiplication et la conservation d’acquis économiques à l’image des « petites sociétés de Tocqueville », s’apparentent au mouvement de « retribalisation de l’individu » que décrit Michel Maffesoli.
L’argent permet d’obtenir et de garder le pouvoir et le pouvoir permet d’obtenir encore plus d’argent3 . Les menaces de délocalisations, conjuguées ou non à des difficultés économiques, semblent avoir obéré notre sens de la liberté.
Pour compléter le tableau, constatons que nous apparaissons comme des acteurs passifs, portés par un développement technologique qui nourrit notre aisance, encouragés par le mirage des écrans et des techniques de communication qui flattent les rêves de perfection et d’immortalité.
C’est comme si nous souhaitions, pour écarter ces craintes nées de frontières mouvantes ou pour se dédouaner du désenchantement, nous réfugier sur le sofa du spectateur, dans la position du zappeur. Et, c’est dans ce home sweet home que nous revendiquons comme un espace privé, que se mènent nos uniques batailles, tristes reflets d’un substitut à notre liberté : supporters, fans, commentateurs, quêteurs à la recherche d’un statut dans la cité ou d’un rang dans la notoriété.
Cependant un autre espace, l’espace public, est consciencieusement déserté. Cette aire de la liberté politique est pourtant « celle des libertés formelles qui assure au citoyen une participation à la chose publique, qui lui donne le sentiment que, par l’intermédiaire de ses élus, éventuellement aussi de ses opinions, il exerce une influence sur le destin de la collectivité. »4 . Comment ne pas croire que cet « homme [qui] s’épuise en petits mouvements solitaires et stériles [alors que] tout en se remuant sans cesse, l’humanité n’avance plus »5 , que cet homme semble avoir retrouvé sa nature profonde, s’est « dé-citoyennisé » puisque comme nous le dit Benjamin Constant, la liberté moderne est le fondement du civisme.
Indignés, indignatos de tous pays, où êtes-vous ?
Kad pour Ciesma
1 Castoriadis, Cornélius, Post-scriptum sur l’insignifiance, Editions de l’aube, 1998
2 Bertho Alain, La crise du politique, l’Harmattan, 1996
3 L’Atlas du monde diplomatique, « Mondialisation et fracture »s, hors série, janvier 2003
4 Aron, Raymond, « Essai sur les liberté »s, hachette littératures, 1998, P 138
5 Hayek Frederik, « La présomption fatale : les erreurs du socialisme », PUF, 1988